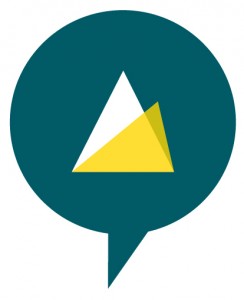Obéissance et soumission à l’autorité
On parle de soumission à l’autorité lorsqu’un individu change de comportement afin de se soumettre aux ordres émanant d’une autorité perçue comme légitime.
Les principales différentes caractéristiques de cette forme d’influence sociale :
– elle se situe à un niveau interindividuel (conformisme et innovation sont des phénomènes intragroupes) ;
– elle implique un différent statut entre source et cible d’influence : un rapport hiérarchique ;
– la pression de la part de la source d’influence est explicite : il y a volonté d’influencer.
L’expérience de Milgram (années 1960-70)
Stanley Milgram (chercheur américain en psycho-sociales) a mené dans les années 50/60 des expériences visant à déterminer où finit la soumission à l’autorité et où commence la responsabilité de l’individu ; comment concilier les impératifs de l’autorité avec la voix de la conscience. Milgram veut déterminer jusqu’où les individus peuvent aller dans des actes odieux, simplement parce qu’une personne qui représente une supériorité le leur a demandé.
Comment expliquer la soumission à l’autorité ?
Des facteurs psychosociaux :
– les sujets obéissent à un personnage doté d’autorité, abandonnent leur état d’autonomie pour adopter un état d’agent. Ils ne se sentent plus responsables de leurs propres actes, se considèrent comme l’instrument de la volonté d’autrui. Ils ne se posent plus la question du bien ou du mal, estiment qu’ils n’ont pas à juger leurs propres comportements ;
– intériorisation d’une norme de soumission : la soumission est une norme sociale apprise dans l’éducation ;
– L’engagement : le choix d’un comportement me pousse à continuer ce comportement (« j’y suis, j’y reste »). Le sujet est progressivement engagé dans l’escalade des punitions.